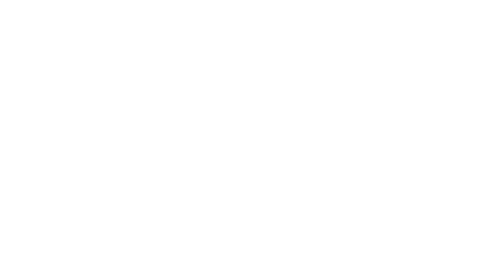Prix Jean CLINQUART 2021
Publié le 17 décembre 2021 – Mis à jour le 3 janvier 2022

La Faculté des Lettres et Civilisations tient à féliciter Cécile BOURNAT-QUÉRAT pour son parcours d’excellence.
Le 8 décembre dernier, Jean-François DUTHEIL, directeur général adjoint des Douanes, et Bruno COLLIN, président de l’AHAD (Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes), remettaient les 5èmes prix « Jean Clinquart » au siège de la direction générale, à Montreuil.
Pour accompagner, encourager, voir même valoriser ce mouvement de recherche historique, l'AHAD a décidé en mai 2011 de créer un prix visant à récompenser les meilleures contributions à l’histoire de la douane ou en lien avec cette histoire. Et tout naturellement, le nom de Jean CLINQUART a été donné à ce prix, en souvenir et en hommage à ce directeur des douanes, disparu en 2010, grand historien de cette Administration, auteur notamment d’une histoire des douanes françaises en 7 volumes, de la Révolution à 1940.
Ancienne étudiante de la Faculté, Cécile BOURNAT-QUÉRAT a poursuivi une Double Licence en Histoire - Géographie avant d’entamer un Master Histoire parcours De la Renaissance aux Révolutions (DDR), elle a été primée par le prix Jean CLINQUART 2021. Son mémoire « Fraude et contrebande à Lyon et dans le Lyonnais (1674-1791) » a été rédigé sous la direction de M. Pierre-Jean SOURIAC.
Depuis, elle a été reçue à l’agrégation d’histoire (2020) et a été acceptée en Contrat doctoral à l’Université d’Aix-Marseille, pour une thèse sous la direction d’Anne MONTENACH portant sur les questions de contrebande et intitulé : "Le Rhône et ses rives : observatoire singulier des pratiques économiques illicites entre Lyon et Arles (XVIIe-XVIIIe siècles)."

L’approche de l’auteure est intéressante en ce qu’elle mêle la description historique au sens strict avec l’étude sociologique des acteurs de la fraude et de leurs motivations (2e partie),et l’examen d’une géographie de la fraude (3e partie).
Cette volonté d’analyse, d’aller au-delà du descriptif a été saluée, car elle permet d’établi un parallèle bien venu entre les évolutions tendancielles de la fraude, marquée par une hausse des atteintes aux biens et une baisse de la criminalité contre les personnes, et la politique mercantiliste qui se mue en « fiscalisme » par l’action de Colbert.
S’agissant de la contrebande, elle rappelle que ce n’est pas un phénomène monolithique mais plutôt “un feuilleté qui relève d’acteurs et de logiques diverses. Le renversement de perspective est intéressant : elle est décrite comme un phénomène non pas principalement issu d’une résistance populaire à une oppression venue d’en haut mais comme une conséquence de la mondialisation.
Il est, bien entendu, fait mention de l’activité de la bande de Mandrin, dont l’exécution publique en 1755 voit s’éteindre ce phénomène de bandes.
Mais on est également très frappé par la proximité entre l’activité des agents de la Ferme générale et l’activité douanière contemporaine : usage de chiens pour détecter la fraude sur le sel ou les tabacs, la rédaction d’un véritable « guide de l’agent verbalisateur » en 1751, la notion de validité des procès verbaux jusqu’à inscription de faux, celle de marchandises « saines loyales et marchandes », l’usage de la commission d’emploi, le recrutement d’aviseurs ou les répartitions effectuées sur les amendes…Nous avons quelques praticiens de la procédure douanière parmi nous. Ils vont apprécier la manière dont était rédigé un procès verbal en 1788.
Autant d’éléments qui nous montrent combien notre droit et nos pratiques contemporaines sont enracinés dans notre histoire.
► Plus d'informations
Le 8 décembre dernier, Jean-François DUTHEIL, directeur général adjoint des Douanes, et Bruno COLLIN, président de l’AHAD (Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes), remettaient les 5èmes prix « Jean Clinquart » au siège de la direction générale, à Montreuil.
Pour accompagner, encourager, voir même valoriser ce mouvement de recherche historique, l'AHAD a décidé en mai 2011 de créer un prix visant à récompenser les meilleures contributions à l’histoire de la douane ou en lien avec cette histoire. Et tout naturellement, le nom de Jean CLINQUART a été donné à ce prix, en souvenir et en hommage à ce directeur des douanes, disparu en 2010, grand historien de cette Administration, auteur notamment d’une histoire des douanes françaises en 7 volumes, de la Révolution à 1940.
Ancienne étudiante de la Faculté, Cécile BOURNAT-QUÉRAT a poursuivi une Double Licence en Histoire - Géographie avant d’entamer un Master Histoire parcours De la Renaissance aux Révolutions (DDR), elle a été primée par le prix Jean CLINQUART 2021. Son mémoire « Fraude et contrebande à Lyon et dans le Lyonnais (1674-1791) » a été rédigé sous la direction de M. Pierre-Jean SOURIAC.
Depuis, elle a été reçue à l’agrégation d’histoire (2020) et a été acceptée en Contrat doctoral à l’Université d’Aix-Marseille, pour une thèse sous la direction d’Anne MONTENACH portant sur les questions de contrebande et intitulé : "Le Rhône et ses rives : observatoire singulier des pratiques économiques illicites entre Lyon et Arles (XVIIe-XVIIIe siècles)."

Communiqué de L'AHAD
L’approche de l’auteure est intéressante en ce qu’elle mêle la description historique au sens strict avec l’étude sociologique des acteurs de la fraude et de leurs motivations (2e partie),et l’examen d’une géographie de la fraude (3e partie).Cette volonté d’analyse, d’aller au-delà du descriptif a été saluée, car elle permet d’établi un parallèle bien venu entre les évolutions tendancielles de la fraude, marquée par une hausse des atteintes aux biens et une baisse de la criminalité contre les personnes, et la politique mercantiliste qui se mue en « fiscalisme » par l’action de Colbert.
S’agissant de la contrebande, elle rappelle que ce n’est pas un phénomène monolithique mais plutôt “un feuilleté qui relève d’acteurs et de logiques diverses. Le renversement de perspective est intéressant : elle est décrite comme un phénomène non pas principalement issu d’une résistance populaire à une oppression venue d’en haut mais comme une conséquence de la mondialisation.
Il est, bien entendu, fait mention de l’activité de la bande de Mandrin, dont l’exécution publique en 1755 voit s’éteindre ce phénomène de bandes.
Mais on est également très frappé par la proximité entre l’activité des agents de la Ferme générale et l’activité douanière contemporaine : usage de chiens pour détecter la fraude sur le sel ou les tabacs, la rédaction d’un véritable « guide de l’agent verbalisateur » en 1751, la notion de validité des procès verbaux jusqu’à inscription de faux, celle de marchandises « saines loyales et marchandes », l’usage de la commission d’emploi, le recrutement d’aviseurs ou les répartitions effectuées sur les amendes…Nous avons quelques praticiens de la procédure douanière parmi nous. Ils vont apprécier la manière dont était rédigé un procès verbal en 1788.
Autant d’éléments qui nous montrent combien notre droit et nos pratiques contemporaines sont enracinés dans notre histoire.
► Plus d'informations
Informations
Mise à jour : 3 janvier 2022